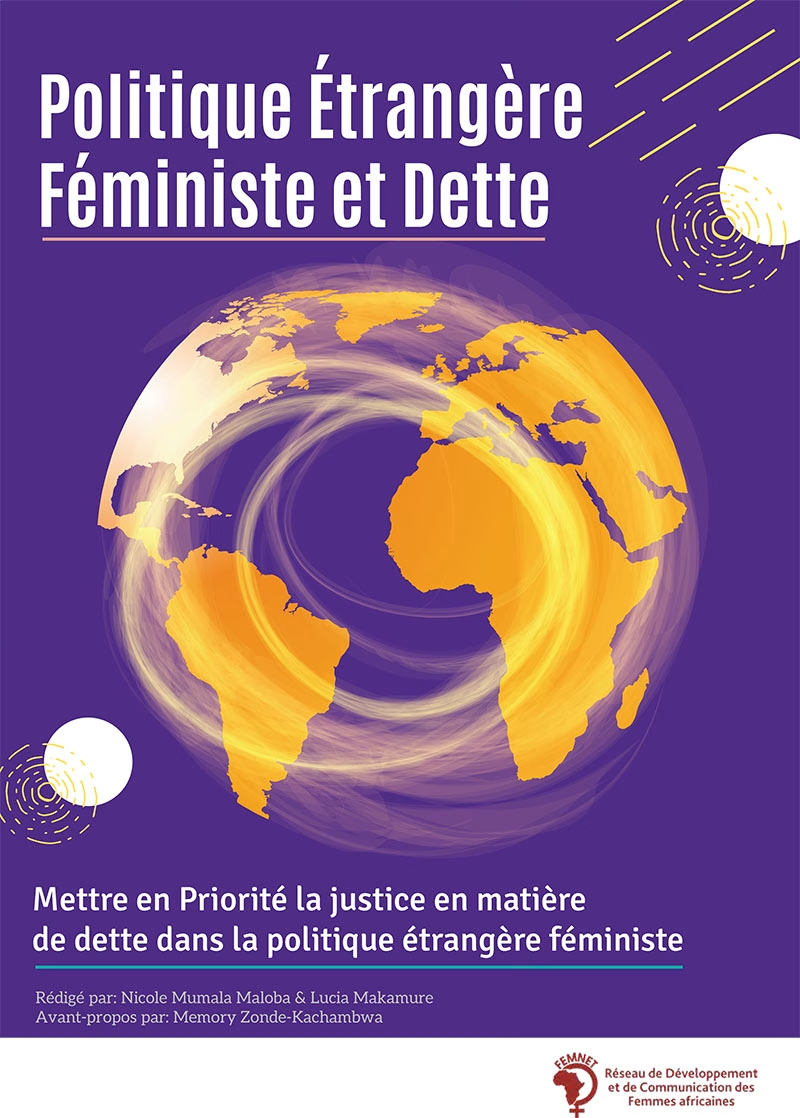
Politique Étrangère Féministe et Dette
En 2014, la Suède est entrée dans l’histoire en adoptant la première politique étrangère féministe (PEF) au monde, créant un précédent qui a inspiré d’autres nations, notamment le Mexique, premier pays du Sud à suivre cet exemple. Cette vague de diplomatie féministe promettait un ordre mondial plus équitable et plus juste. Cependant, cette même décennie a également été marquée par de profonds bouleversements géopolitiques.
Le monde a été confronté à une escalade du militarisme et des conflits, aux assauts incessants du changement climatique, à la pandémie dévastatrice du COVID-19, au rétrécissement des espaces civiques et à la montée en puissance des mouvements antisexistes et du fondamentalisme. Le paysage économique a été tout aussi turbulent, les pays du Sud, en particulier l’Afrique, étant confrontés à une crise de la dette de plus en plus grave. Cette pression financière a ravivé les mesures d’austérité et les programmes d’ajustement structurel, exacerbant la détresse et l’agitation dans de nombreux pays. Alors que nous réfléchissons au double récit du progrès et de la crise, le parcours de la politique étrangère féministe constitue une lueur d’espoir dans un contexte de défis mondiaux.
La dette est étroitement liée à un cadre colonial et extractif qui sous-tend le système financier mondial, piégeant systématiquement les pays du Sud et les anciennes colonies dans un cycle implacable d’emprunts avec peu ou pas d’alternatives. Cette structure oppressive oblige les nations surendettées à donner la priorité aux remboursements au détriment de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale et du bien-être de leurs citoyens, tout en étant confrontées aux dures réalités des agences de notation prédatrices qui sont à la fois vicieuses et impitoyables. Ce cycle perpétue les inégalités et sape la souveraineté et la dignité de ces nations, soulignant le besoin urgent d’une réimagination féministe de la justice économique mondiale.
Les approches néolibérales et néocoloniales dominantes au niveau mondial préconisent des mesures d’austérité, prescrivent la privatisation et la mise en œuvre de modèles de financement complexes, y compris le financement de la lutte contre le changement climatique. Ces actions conduisent aux réductions des financements publics et aux privatisations importantes, qui manquent souvent de transparence et sont motivées par la recherche des bénéfices. Par conséquent, elles négligent les besoins et les priorités des citoyens qu’elles sont censées servir. Ce cycle systémique et structurel est injuste, oppressif et profondément enraciné dans un programme colonial extractiviste.






